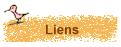La
Noel du petit joueur de violon
La
Noel du petit joueur de violon
Il était une fois, – il y a si longtemps que tout le monde a oublié la date, – dans une ville du nord de l’Europe, – dont le nom est si difficile à prononcer que personne ne s’en souvient, – il était une fois un petit garçon de sept ans, nommé Wolff, orphelin de père et de mère, et resté à la charge d’une vieille tante, personne dure et avaricieuse, qui n’embrassait son neveu qu’au Jour de l’An et qui poussait un grand soupir de regret chaque fois qu’elle lui servait une écuellée de soupe.
Mais le pauvre petit était d’un si bon naturel, qu’il aimait tout de même la vieille femme, bien qu’elle lui fit grand peur et qu’il ne pût regarder sans trembler la grosse verrue, ornée de quatre poils gris, qu’elle avait au bout du nez.
Comme la tante de Wolff était connue de toute la ville pour avoir pignon sur rue et de l’or plein un vieux bas de laine, elle n’avait pas osé envoyer son neveu à l’école des pauvres ; mais elle avait tellement chicané, pour obtenir un rabais, avec le magister chez qui le petit Wolff allait en classe, que ce mauvais pédant, vexé d’avoir un élève si mal vêtu et payant si mal, lui infligeait très souvent, et sans justice aucune, l’écriteau dans le dos et le bonnet d’âne, et excitait même contre lui ses camarades, tous fils de bourgeois cossus, qui faisaient de l’orphelin leur souffre-douleur.
Le pauvre mignon était donc malheureux comme les pierres du chemin et se cachait dans tous les coins pour pleurer, quand arrivèrent les fêtes de Noël.
La veille du grand jour, le maître d’école devait conduire tous ses élèves à la messe de minuit et les ramener chez leurs parents.
Or, comme l’hiver était très rigoureux, cette année-là, et comme, depuis plusieurs jours, il était tombé une grande quantité de neige, les écoliers vinrent tous au rendez-vous chaudement empaquetés et emmitouflés, avec bonnets de fourrure enfoncés sur les oreilles, doubles et triples vestes, gants et mitaines de tricot et bonnes grosses bottines à clous et à fortes semelles. Seul, le petit Wolff se présenta grelottant sous ses habits de tous les jours et des dimanches, et n’ayant aux pieds que des chaussons de Strasbourg dans de lourds sabots.
Ses méchants camarades, devant sa triste mine et sa dégaine de paysan, firent sur son compte mille risées ; mais l’orphelin était tellement occupé à souffler sur ses doigts et souffrait tant de ses engelures, qu’il n’y prit pas garde. – Et la bande de gamins, marchant deux par deux, magister en tête, se mit en route pour la paroisse.
Il faisait bon dans l’église, qui était toute resplendissante de cierges allumés ; et les écoliers, excités par la douce chaleur, profitèrent du tapage de l’orgue et des chants pour bavarder à demi-voix. Ils vantaient les réveillons qui les attendaient dans leurs familles. Le fils du bourgmestre avait vu, avant de partir, une oie monstrueuse, que des truffes tachetaient de points noirs comme un léopard. Chez le premier échevin, il y avait un petit sapin dans une caisse, aux branches duquel pendaient des oranges, des sucreries et des polichinelles. Et la cuisinière du tabellion avait attaché derrière son dos, avec une épingle, les deux brides de son bonnet, ce qu’elle ne faisait que dans ses jours d’inspiration, quand elle était sûre de réussir son fameux plat sucré.
Et puis, les écoliers parlaient aussi de ce que leur apporterait le petit Noël, de ce qu’il déposerait dans leurs souliers, que tous auraient soin, bien entendu, de laisser dans la cheminée avant d’aller se mettre au lit ; – et dans les yeux de ces galopins, éveillés comme une poignée de souris, étincelait par avance la joie d’apercevoir, à leur réveil, le papier rose des sacs de pralines, les soldats de plomb rangés en bataillon dans leur boîte, les ménageries sentant le bois verni et les magnifiques pantins habillés de pourpre et de clinquant.
Le petit Wolff, lui, savait bien, par expérience, que sa vieille avare de tante l’enverrait se coucher sans souper ; mais, naïvement, et certain d’avoir été, toute l’année, aussi sage et aussi laborieux que possible, il espérait que le petit Noël ne l’oublierait pas, et il comptait bien, tout à l’heure, placer sa paire de sabots dans les cendres du foyer.
La messe de minuit terminée, les fidèles s’en allèrent, impatients du réveillon, et la bande des écoliers, toujours deux par deux et suivant le pédagogue, sortit de l’église.
Or, sous le porche, assis sur un banc de pierre surmonté d’une niche ogivale, un enfant était endormi, un enfant couvert d’une robe de laine blanche, et pieds nus, malgré la froidure. Ce n’était point un mendiant, car sa robe était propre et neuve, et, près de lui, sur le sol, on voyait, liés dans une serge, une équerre, une hache, une bisaiguë, et les autres outils de l’apprenti charpentier. Éclairé par la lueur des étoiles, son visage aux yeux clos avait une expression de douceur divine, et ses longs cheveux bouclés, d’un blond roux, semblaient allumer une auréole autour de son front. Mais ses pieds d’enfant, bleuis par le froid de cette nuit cruelle de décembre, faisaient mal à voir.
Les écoliers, si bien vêtus et chaussés pour l’hiver, passèrent indifférents devant l’enfant inconnu ; quelques-uns même, fils des plus gros notables de la ville, jetèrent sur ce vagabond un regard où se lisait tout le mépris des riches pour les pauvres, des gras pour les maigres.
Mais le petit Wolff, sortant de l’église le dernier, s’arrêta tout ému devant le bel enfant qui dormait.
– « Hélas ! se dit l’orphelin, c’est affreux ! Ce pauvre petit va sans chaussures par un temps si rude... Mais, ce qui est encore pis, il n’a même pas, ce soir, un soulier ou un sabot à laisser devant lui, pendant son sommeil, afin que le petit Noël y dépose de quoi soulager sa misère ! »
Et, emporté par son bon cœur, Wolff retira le sabot de son pied droit, le posa devant l’enfant endormi, et, comme il put, tantôt à cloche-pied, tantôt boitillant et mouillant son chausson dans la neige, il retourna chez sa tante.
– « Voyez le vaurien ! s’écria la vieille, pleine de fureur au retour du déchaussé. Qu’as-tu fait de ton sabot, petit misérable ? »
Le petit Wolff ne savait pas mentir, et bien qu’il grelottât de terreur en voyant se hérisser les poils gris sur le nez de la mégère, il essaya, tout en balbutiant, de conter son aventure.
Mais la vieille avare partit d’un effrayant éclat de rire.
– « Ah ! Monsieur se déchausse pour les mendiants ! Ah ! Monsieur dépareille sa paire de sabots pour un va-nu-pieds !... Voilà du nouveau, par exemple !... Eh bien, puisqu’il en est ainsi, je vais laisser dans la cheminée le sabot qui te reste, et le petit Noël y mettra cette nuit, je t’en réponds, de quoi te fouetter à ton réveil... Et tu passeras la journée de demain à l’eau et au pain sec... Et nous verrons bien si, la prochaine fois, tu donnes encore tes chaussures au premier vagabond venu ! »
Et la méchante femme, après avoir donné au pauvre petit une paire de soufflets, le fit grimper dans la soupente où se trouvait son galetas. Désespéré, l’enfant se coucha dans l’obscurité et s’endormit bientôt sur son oreiller trempé de larmes.
Mais, le lendemain matin, quand la vieille, réveillée par le froid et secouée par son catarrhe, descendit dans sa salle basse, – ô merveille ! – elle vit la grande cheminée pleine de jouets étincelants, de sacs de bonbons magnifiques, de richesses de toutes sortes ; et, devant ce trésor, le sabot droit, que son neveu avait donné au petit vagabond, se trouvait à côté du sabot gauche, qu’elle avait mis là, cette nuit même, et où elle se disposait à planter une poignée de verges.
Et, comme le petit Wolff, accouru aux cris de sa tante, s’extasiait ingénument devant les splendides présents de Noël, voilà que de grands rires éclatèrent au dehors. La femme et l’enfant sortirent pour savoir ce que cela signifiait, et virent toutes les commères réunies autour de la fontaine publique. Que se passait-il donc ? Oh ! Une chose bien plaisante et bien extraordinaire ! Les enfants de tous les richards de la ville, ceux que leurs parents voulaient surprendre par les plus beaux cadeaux, n’avaient trouvé que des verges dans leurs souliers.
Alors, l’orphelin et la vieille femme, songeant à toutes les richesses qui étaient dans leur cheminée, se sentirent pleins d’épouvante. Mais, tout à coup, on vit arriver M. le curé, la figure bouleversée. Au-dessus du banc placé près de la porte de l’église, à l’endroit même où, la veille, un enfant, vêtu d’une robe blanche et pieds nus, malgré le grand froid, avait posé sa tête ensommeillée, le prêtre venait de voir un cercle d’or, incrusté dans les vieilles pierres.
Et tous se signèrent dévotement, comprenant que ce bel enfant endormi, qui avait auprès de lui des outils de charpentier, était Jésus de Nazareth en personne, redevenu pour une heure tel qu’il était quand il travaillait dans la maison de ses parents, et ils s’inclinèrent devant ce miracle que le bon Dieu avait voulu faire pour récompenser la confiance et la charité d’un enfant.
François Coppée
La Noël du petit joueur de violon
I
– Jean, dit à son domestique M. Cappelle de la maison Cappelle et Cie,allez donc voir quel est ce tapage à la porte de la rue.
– Je n’ai pas besoin de me déranger, monsieur Cappelle, pour savoir que c’est le petit mendiant à qui vous m’avez fait donner deux sous ce matin, répondit Jean en regardant par la fenêtre du bureau.
– Ces mendiants ne nous laisseront donc jamais tranquilles, s’écria M. Cappelle. Tous les ans, je donne cent francs au bourgmestre pour les pauvres de la ville. Dites-lui cela, Jean, de ma part, et faites-le partir.
– Attendez un peu que j’aie fini d’épousseter votre grand fauteuil, monsieur Cappelle, et vous verrez si je n’irai pas le lui dire. C’est incroyable comme il y a toujours de la poussière dans votre bureau. Comment donc ! Cent francs aux pauvres de la ville ! Je lui dirai cela, soyez tranquille, et s’il lui prend envie de recommencer, je lui dirai par-dessus le marché que je n’ai pas le temps de courir du matin au soir après des rien-du-tout, des gueux, des rats, monsieur Cappelle...
Et Jean donnait de si furieux coups de son plumeau sur le fauteuil que les plumes se détachaient par poignées... – Oui, monsieur Cappelle, des rats. Cent francs par an ! Vous badinez, je pense.
– Doucement, s’il vous plaît, Jean, vous allez déchirer le cuir de mon fauteuil. J’entends de nouveau le violon. Sortirez-vous à la fin ?
– Oui, monsieur Cappelle, fit Jean, en passant son plumeau sous son bras. Mettez-vous seulement un peu à la fenêtre pour entendre comment je vais l’arranger.
Puis il se planta au milieu du bureau, croisa ses bras, et regardant son maître d’un air attendri, la tête sur le côté, s’écria :
– Est-il Jésus Dieu possible que des rien-du-tout, des gueux, des rats, oui, des rats, monsieur Cappelle, viennent ennuyer jusque dans sa maison un monsieur si honnête, et qui donne cent francs par an aux pauvres de la ville ? Non, monsieur, cela n’est pas croyable.
Ayant ainsi parlé, Jean se dirigea lentement du côté de la porte, les bras croisés et le nez en terre, avec de petits hochements de tête, comme un homme qui médite sur ce qu’il vient de dire, mais, au moment de sortir, il releva les yeux, et interpellant son maître :
– Ainsi donc, monsieur Cappelle, je lui dirai de votre part... Qu’est-ce qu’il faudra dire, s’il vous plaît, monsieur ?
– Jean ! Attendez un peu, cria en ce moment une joyeuse voix de petite fille.
Et Hélène, que tout le monde appelait Leentje dans la maison, entra en sautillant dans le bureau de son père. Oh ! La jolie enfant ! Elle avait dix ans, les joues roses, les cheveux blonds, les yeux bruns, et sa grande tresse serrée dans des noeuds de soie bleue battait son dos, comme une gerbe d’épis tressés.
– Père, supplia-t-elle, un petit sou pour le joueur de violon qui est devant la porte de la maison. Jean ira le lui porter.
Mais M. Cappelle lui répondit avec humeur :
– Qu’as-tu à t’occuper de cet affreux petit drôle ? J’en ai assez de sa manivelle.
– Ah ! Père, il est si gentil, fit l’enfant en joignant les mains, très doucement, et il joue si bien ; il n’a peut-être plus de père, car enfin... Est-ce que tu me laisserais aller jouer du violon aux portes des maisons, père ?
– Leentje, voilà une sotte question... Qu’y a-t-il de commun entre nous et les pauvres gens ? Tu es la fille de Jacob Cappelle, de la maison Cappelle et Cie.
– La plus riche maison de la ville, Leentje, dit Jean en crachant derrière sa main, dans le corridor.
– Eh bien, père... Tiens ! je voulais te dire quelque chose de très raisonnable et voilà que j’ai oublié... Attends. Ah ! je sais maintenant... Je ne voudrais jamais que ma poupée manquât de rien tant que je serai vivante, et pourtant je ne suis que sa maman. Voyons, un petit sou, s’il te plaît, papa, ou je le prends sur l’argent de mes économies.
– Tiens, voilà le sou, Leentje, mais c’est le dernier qu’aura ce petit mendiant. À votre âge, mademoiselle, j’étais déjà plus sérieux : je m’occupais des intérêts de la maison, au lieu de prendre attention à des coureurs de rue.
– Je suis pourtant bien sage, père. Je sais tous les jours ma leçon et j’ai eu hier encore trois bons points pour mon écriture.
– Oui, ma chérie, mais tu es pendue tout le jour à ma poche. Un sou est un sou, et dix sous font un franc, et un franc avec d’autres francs font au bout de l’année un joli intérêt. Crois-tu qu’on nous donnerait comme cela des sous à la porte des maisons si nous étions pauvres ?
Ici Jean crut devoir intervenir, et crachant encore une fois derrière sa main, dans le corridor, il s’écria :
– Ah bien, non, Leentje, qu’on ne nous les donnerait pas. Un si bon monsieur et qui, tous les ans, donne cent francs aux pauvres ! Ah bien, non, et pour ma part, monsieur Cappelle, je vous dirais : Allez-vous-en ; nous avons bien assez déjà de nos pauvres, auxquels nous payons cent francs par an. Est-ce que je mendie, moi ? Je suis domestique chez monsieur Cappelle et je travaille. Eh bien, travaillez aussi. Voilà ce que je dirais.
M. Cappelle haussa les épaules, et poussant du doigt Leentje vers la porte :
– Allons, fillette, dit-il, va avec Jean. Voici la fin de l’année et j’ai à revoir mes livres de comptes.
Ils descendirent et brusquement Jean se mit à crier de toute la force de ses poumons :
– Hé ! Là-bas ! Hé ! Mendiant ! Garnement ! Propre à rien !
L’archet cessa de faire grincer les cordes du violon et un jeune garçon se leva de la marche en pierre sur laquelle il était assis, dans l’encoignure d’une porte. Alors Jean prit un air majestueux et la main tendue, comme un avocat qui commence un plaidoyer :
– Monsieur Cappelle vous fait dire, de sa part, qu’il donne cent francs par an aux pauvres de la ville et que...
– Venez, petit, venez par ici, interrompit Leentje, poussant à travers la porte sa jolie tête rose.
Et de la main, elle lui faisait signe d’approcher.
Le petit mendiant qui avait ôté son chapeau, en souriant gauchement, quand Jean s’était mis à lui parler, entra dans le grand vestibule peint en marbre blanc, étonné, regardant la hauteur des voûtes, avec de réitérés mouvements de tête humbles et lents pour saluer.
Jean ferma la porte, examina le garçon des pieds à la tête et tout à coup indigné, montra Leentje et s’écria :
– Savez-vous bien à qui vous parlez ? À Leentje, la fille de M. Cappelle. Et M. Meganck, le notaire lui-même, n’est pas plus riche que M. Cappelle, quoique son cocher ait un frac avec de l’argent dessus.
Mais l’enfant avait posé le doigt sur les haillons du musicien :
– N’ayez pas peur, dit-elle, et répondez-moi. Vous n’avez plus de père, petit ?
Il fixait à présent les yeux sur la pointe de ses pauvres vieux souliers, haussant les épaules, doucement, pour montrer qu’il ne comprenait pas ; puis par contenance, un poing sur sa hanche, il se mit à siffler dans ses dents, d’un air à la fois timide et résolu.
– Bon ! c’est un sourd-muet, s’exclama Jean. J’ai vu ça de suite. Voyons, répondez. N’est-ce pas que vous êtes sourd-muet ?
– Comment voulez-vous qu’il soit sourd-muet, Jean, puisqu’il chantait hier en jouant du violon ?
Alors le jeune garçon mit son instrument sous son menton et ouvrit la bouche comme s’il s’apprêtait à chanter ; mais Leentje posa la main sur l’archet et lui dit :
– Moi, j’aime le violon, mais mon papa ne l’aime pas. Je vous ai demandé si vous n’aviez plus de papa ? Est-ce que vous ne m’avez pas compris ?
Il leva sur Leentje deux beaux grands yeux noirs, doux comme du velours, et haussa de nouveau ses épaules ; mais cette fois un triste sourire plissait le coin de sa petite bouche bien formée.
– Ah ! s’écria tout à coup Leentje gaiement, en frappant ses mains l’une dans l’autre, il veut dire qu’il n’est pas du pays. D’où viendrait-il, Jean ?
Jean fit alors le tour du jeune garçon, les mains derrière le dos, levant et abaissant son long nez de travers pour mieux voir les habits du petit mendiant, et une grimace dédaigneuse plissait le bas de sa grosse figure bien nourrie.
– Tenez, lui dit Leentje, j’ai demandé à mon père un sou que voici et j’y joins trois sous qui m’appartiennent. Cela vous fait quatre sous pour vous acheter un gâteau, car c’est la Noël ce soir. J’ai bien encore vingt sous dans ma tirelire, mais j’ai promis de les donner à la vieille Catherine. Amusez-vous bien : une autre fois je vous montrerai ma poupée. Vous ne la connaissez pas ? Elle a coûté vingt francs. C’est une poupée très jolie.
Et Leentje mit ses quatre sous dans les doigts du jeune garçon. Il eut un beau geste reconnaissant, et de la main dans laquelle Leentje avait glissé les sous, il frappa sa poitrine avec tant de vivacité qu’elle le regarda pour savoir s’il ne s’était pas fait de mal. Il baissa aussitôt les yeux et une grosse larme coula sur ses joues pâles, tandis qu’il portait son argent à sa bouche et le baisait religieusement.
– Il poverello ! cria-t-il tout à coup d’une seule voix, avec une grande énergie.
Et glissant très vite son violon sous son menton, il posa l’archet sur les cordes et ouvrit la bouche, en regardant en l’air, la tête sur l’épaule.
– Leentje ! Leentje ! Cria une voix dans l’escalier.
Et Mina, la bonne, parut dans le corridor, tout essoufflée.
– Que faites-vous ici, Leentje ? Je vous cherche dans toute la maison. Est-il permis de faire courir ainsi les gens ! Dieu du ciel ! Mon corset vient de craquer. Je serai obligée de remettre une agrafe.
Mais elle, toute à son admiration :
– Voyez, Mina, quel gentil petit garçon ! C’est le même qui nous a suivies dimanche quand nous sommes allées, Nelle et moi, à la boutique de M. Pouffs, le marchand de volailles, car vous étiez retournée ce jour-là chez vos parents, Mina. Il jouait du violon en nous suivant. Nelle a voulu le chasser en lui montrant son poing, mais il n’a pas eu peur de Nelle, et seulement il a mis son violon sous son bras. Ne trouvez-vous pas qu’il est bien gentil, Mina ?
– Comment pouvez-vous trouver gentil un affreux petit garçon sale, noir, mal lavé et qui porte les cheveux si longs, Leentje ? Je n’ai jamais rien vu de plus laid que ce vilain petit singe, et vous feriez mieux de ne pas m’exposer à prendre un rhume en vous attendant.
– Mina ! Mina ! pourquoi dites-vous du mal de mon petit mendiant après l’avoir trouvé si gentil hier au soir, car je vous ai donné hier une pièce neuve de cinquante centimes pour la lui remettre, et vous êtes remontée en disant que vous n’aviez jamais vu un plus doux ni plus joli mouton.
– Bon, Leentje, ce que je vous en dis aujourd’hui est pour vous mettre un peu en colère contre moi. C’est un doux mouton, voilà.
– Un doux et un joli mouton, Mina.
– Oui, tout ce que vous voudrez, Leentje, un doux et joli mouton. Êtes-vous contente ? Je sais très bien que vous m’avez donné une jolie pièce de cinquante centimes toute neuve, avec la tête du roi Léopold dessus. Oui, je la vois encore d’ici.
Elle toussait en parlant, un peu gênée, car elle l’avait gardée pour elle.
Et Mina était, en effet, descendue la veille pour remettre la pièce au jeune garçon ; mais au moment d’ouvrir la porte, elle avait vu le fils du sacristain Klokke à genoux dans la neige et cherchant à regarder par la fenêtre de la cave. Et Klokke, qui était jaloux, lui avait dit :
– Pourquoi venez-vous à la porte, Mina ? Est-ce que vous m’avez entendu frapper contre la vitre ? J’ai pourtant frappé bien doucement. Je suis sûr que quelqu’un a rendez-vous à cette heure avec vous. Est-ce le gros Luppe, le Crollé, ou Metten, le cocher de M. Meganek ? Dites-le-moi, Mina, ou je vous pince.
– Qu’est-ce que vous me chantez là ? S’était écriée la grosse petite bonne. Vous êtes toujours planté devant le carreau pour savoir ce que je fais. Klokke ! C’est fini. Je ne veux plus rien avoir pour vous. Mariez-vous ailleurs. J’en ai assez de toutes vos raisons. Qu’est-ce que vous dites ?
– Eh bien, si c’est comme cela, je m’en vais. J’en ai assez de tous les museaux que je vois tourner par ici. Vous avez beau dire, je pars pour ne plus revenir.
– Je ne dis rien.
– Non, non, c’est inutile. Nous irons chacun de notre côté. J’en connais qui vous valent bien, et il n’y a que le choix qui m’embarrasse. Votre amie Justine...
– Eh bien ! Prenez Justine : je vous l’abandonne, avec son cou sur le côté et son air de n’y pas toucher. Votre ami Dirk...
– Prenez Dirk. Voilà un joli mufle. Sans compter qu’il boit tout son mois en un jour. Il y a bien de quoi faire la fière !
– Vous me rendrez mon mouchoir et mon gant, s’il vous plaît, avant dimanche, car je ne veux plus que vous ayez rien à moi.
– Ni moi non plus. Vous me rendrez le cent d’aiguilles et le petit pot de pommade.
– Le petit pot de pommade ! Il y a beau temps qu’il n’y en a plus, de la pommade, dans votre petit pot. Allez, ne me retenez pas plus longtemps. Je suis bien sotte de vouloir encore causer avec vous.
– Eh bien ! Gardez le petit pot, Mina, en souvenir de moi, et s’il vous en faut encore un...
– Je ne vous connais plus.
– Hein ?
– Bonsoir.
– Voyons, Mina, est-ce moi que vous attendiez, ou un autre ?
– Rien...
– Dites-moi si tout est fini entre nous ?
– Bonsoir.
– Ah ! Mina, le pauvre Klokke a-t-il mérité d’être aussi durement traité ?
– Prenez Justine.
– Ce sont là des histoires, ma petite Mina ; je n’ai rien pour Justine.
– Il n’y a que le choix qui vous embarrasse.
– J’étais venu avec l’intention de vous donner...
– Hein ?
– Mais c’est inutile, puisque tout est rompu.
– Dites toujours.
– Non, cela ne sert à rien.
– Voyons un peu.
– À quoi bon ?
– C’est pour voir.
– Ce sera pour une autre.
– Alors, bonsoir.
– Mina, dites-moi pourquoi vous êtes venue à la porte et je vous dirai...
– Ah ! Klokke, vous ne méritez pas qu’on vous aime. Qu’est-ce que c’est que vous me donnez ?
– Mina, je vous apportais une petite broche en jais.
– Montrez un peu pour voir. Mon petit Klokke, c’est très gentil d’avoir pensé à votre Mina. On voit bien l’amitié que les gens ont pour quelqu’un aux cadeaux qu’ils lui font.
– Maintenant, Mina, nous ne nous quitterons plus. Dites-moi pourquoi vous avez ouvert la porte ?
– Ah ! Klokke, c’est pour cet affreux mendiant qui jouait tantôt du violon devant la maison. Où est-il ? L’avez-vous vu partir ?
– Le voilà qui tourne le coin de la rue.
– Leentje m’a donné de l’argent pour lui.
– Hem ! Hem !
– Pourquoi faites-vous hem ! Hem ! Klokke ?
– C’est que si j’étais à votre place, Mina...
– Que feriez-vous à ma place ?
– Je sais bien ce que je ferais. Les mendiants sont assez riches comme cela.
– N’en dites rien à personne, Klokke. Nous le mettrons avec les autres pour le jour de notre mariage.
– Ah ! Mina, il y aura toujours du pain sur la planche avec une femme comme vous.
Et voilà comment il se fait que le petit mendiant n’eut pas la jolie pièce que Leentje avait donnée pour lui à la bonne amie de Klokke, le fils du sacristain. Mais la fine Mina n’avait garde d’en rien laisser paraître et elle faisait à présent semblant de se rappeler très bien qu’elle la lui avait donnée.
– C’est égal, Leentje, dit-elle, vous feriez mieux de ne pas vous occuper de ces petits traîneurs de pavé. Ce sont tous des fripons et des fils du diable. J’en ai vu comme cela pas mal à Bruxelles, quand j’étais en service chez M. Schoreels, le ferblantier, et j’entendais dire autour de moi qu’ils venaient de si loin que c’était au moins de Macaroni ou d’Italie, je ne sais plus au juste, mais c’est quelque chose comme cela.
– Mina ! Mina ! C’est donc plus loin que Bruxelles. Ah ! Pauvre petit garçon ! Je lui garderai certainement un morceau du gâteau de Noël.
– Voilà votre père qui vous appelle. Rentrez vite, de peur qu’il ne vous trouve encore dans le vestibule.
– Bonsoir, petit mendiant, dit alors l’enfant, en faisant aller ses mignonnes mains ; maman m’a appris à prier Dieu pour les pauvres. Je dirai dimanche à la messe une prière pour que vous soyez toujours un gentil petit garçon.
Alors Jean, redevenu hautain, le bourra dans les épaules.
– Allons, sortez d’ici. M. Cappelle vous fait dire de sa part qu’il donne tous les ans cent francs aux pauvres de la ville.
– Vous êtes bien dur, Jean, dit Leentje.
– Qui ça ? Moi, dur, Leentje ? On m’a toujours dit que j’avais un cœur de poulet.
– Vous le rudoyez.
– Le rudoyer ! Moi ! Sortirez-vous à la fin, vilain rat ?
Le petit mendiant regarda l’argent qu’il avait dans la main, murmura quelques mots que personne ne comprit et gagna la rue. Au moment de sortir, il leva ses yeux noirs sur Jean, avec colère.
– Allez ! Allez ! lui cria Jean, je me moque de vos grands yeux. Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis ici dans un bon service où je ne manque de rien et où je gagne de bon argent. Propre à rien ! Brigand !
Et la porte se ferma.
II
Le petit joueur de violon remit son chapeau sur sa tête, serra autour de ses reins le vieux manteau bleu qu’une corde attachait à son corps et se mit à remonter la rue en frappant ses pieds gelés sur le pavé plein de neige.
Le soir tombait et le long des façades les vitres s’éclairaient l’une après l’autre. Des lampes brillaient sur les tables. De temps en temps, une fenêtre s’ouvrait sur la lumière chaude des chambres ; un homme ou une femme se penchait, fermait les volets. Les vitrines des boutiques, scintillantes de givre, étalaient des arabesques, légères comme des dentelles, sur lesquelles dansait l’ombre des brosses, des torchons, des paquets de chandelles et des nattes en paille qui pendaient à l’étalage. On voyait les boutiquiers aller et venir avec empressement derrière leur comptoir, en riant, parce que les gros sous pleuvaient ce soir-là dans leur tiroir, et les chalands tapaient leurs sabots à terre pour se réchauffer, en attendant leur tour d’être servis.
La vitrine du marchand de vin était une vraie merveille ; le malin compère avait rangé l’une à côté de l’autre, sur les planches, toute une armée de bouteilles, renfermant de belles liqueurs roses, brunes, jaunes et violettes que la lumière de la lampe faisait miroiter comme des topazes, des rubis, des améthystes et des saphirs. Et sur le trottoir, la neige se colorait de feux qui reflétaient la nuance des liqueurs dans les bouteilles. Près de là, le charcutier avait pendu à sa fenêtre de longs chapelets de saucissons, enguirlandés de fleurs en papier d’or, et de la belle saucisse luisante tournait en rond sur une assiette, à côté d’un grand foie de porc dont le brave homme était en train de couper une tranche.
L’enfant poussa la porte qui se mit à carillonner, et du doigt montra le foie.
– Qu’est-ce que c’est, mon petit bonhomme ? lui dit le marchand. Je veux bien vous donner une tranche de foie, mais il faut me la payer.
Et en même temps il frottait plusieurs fois de suite son pouce contre son index pour donner plus de poids à ses paroles.
L’enfant tira de sa poche un de ses sous et le mit sur le comptoir, en passant sa main dessus, de crainte que l’homme ne le prit avant de l’avoir servi. Le grand couteau luisant plongea alors dans le foie et une tranche s’en détacha ; puis le petit mendiant ôta sa main de dessus le sou et s’en alla, emportant sa marchandise. Il avait grand’faim, il mordait dans la tranche à belles dents, et en un instant il n’en resta plus rien. Il glissa alors sa main dans sa poche pour voir s’il avait encore ses autres sous et continua son chemin.
Le pâtissier avait imaginé pour la Noël une montre extraordinaire. Des cramiques étalaient leurs dos bruns piqués de raisins, laissant sortir par places la miche dorée ; et une pièce montée, superbe, avait la forme d’une tour. Cette tour, dont la base était en pâte de pouding, étageait trois rangs de galeries circulaires ; en haut de la dernière, parmi les fruits confits qui brillaient sur le sucre de la croûte glacée, une petite femme en jupe blanche, posée sur l’orteil du pied gauche, haussait en l’air sa jambe droite en ouvrant les bras comme si elle allait s’envoler. Puis des meringues soulevaient, non loin de la tour, leur écume figée au milieu de laquelle deux cerises et une prune semblaient des îlots battus par les flots. Contre la vitre, de grandes couques hérissées de drapeaux en soie rouge et bleue et de plumes frisées posaient debout, à côté d’hommes en spikelaus et en biscuit, qui avaient l’air de dire bonjour aux passants. Il y avait aussi des assiettes remplies de dragées, de pralines au chocolat, de fondants, de sucres de couleur, de caramels, mais la plus belle chose était certainement la tour aux trois étages, à cause de sa hauteur et de ses fruits.
Le petit vagabond s’arrêta longtemps devant ces merveilles, n’ayant jamais rien vu d’aussi beau. Il se baissait, se haussait, se penchait à droite, se penchait à gauche, faisait avec son haleine des trous dans le givre des vitres, pour mieux voir. Et tantôt il sautait sur une jambe tantôt sur l’autre, frappant ses vieilles semelles sur le trottoir et chantant entre ses dents un air de son pays. Doucement il passa le bout de sa langue sur la vitre et lécha le givre à petits coups, croyant lécher les confitures.
Le pâtissier s’aperçoit tout à coup qu’il y a quelqu’un derrière sa vitrine et il fait un geste de colère. Le petit joueur se sauve alors ; mais le boulanger, lui aussi, a fait de grands hommes en spikelaus, des cramiques de fine farine, des couques en forme d’oiseau, avec des plumes et des drapeaux. Et l’enfant s’arrête de nouveau, regarde ces belles choses avec le désir d’en manger.
Il n’a pris, depuis le matin, pour toute nourriture, qu’un petit pain de deux sous et une tranche de foie. À la fin il se décide, pousse la porte vitrée du maître mitron, montre du doigt les bonshommes qui sont à la vitrine, et parmi ceux-là le plus beau. Mais la boulangère appuie le pouce de sa main droite sur la paume de sa main gauche, l’avertissant ainsi qu’il doit avant tout payer. Il tire son sou et le pose sur le comptoir.
La méchante femme hausse alors les épaules et lui dit d’une voix aigre :
– Avez-vous pensé vraiment, petit drôle, que vous auriez ce grand bonhomme pour un sou ?
Puis elle prend le sou, le tourne dans ses doigts et lui donne un petit pain blanc, le plus sec de la fournée.
Comme c’est bon, du pain ! Il l’avale en quelques coups de dents et porte ensuite sa main à sa bouche pour y ramasser les miettes roulées dans les coins.
III
Constamment la sonnette des marchands carillonne ses drelin drelin ; car de riches et pauvres vont à la boutique, ce soir-là, pour acheter les cadeaux de Noël. Les ménagères passent en courant, la tête baissée sur la poitrine, les mains pelotonnées dans leur tablier, à cause de la bise qui rougit le nez et les doigts : et l’une tient dans les bras un cramique qui répand derrière elle une bonne odeur de pâte aux œufs, l’autre porte à son poignet un cabas d’où sortent des goulots de bouteilles. Des petits garçons et des petites filles passent aussi, chargés de provisions, et quelques-uns s’arrêtent pour ouvrir les paquets et prendre délicatement un bonbon, un morceau de sucre, un macaron.
De vieilles femmes, enveloppées de manteaux et le capuchon sur les yeux, sortent de l’église en marmottant entre leurs dents, qui claquent de froid, et il y en a qui tiennent à la main une chaufferette par les trous de laquelle le vent fait pétiller la braise.
Le petit musicien voit briller dans la noire église les hautes fenêtres en forme de trèfle ; la porte étant restée ouverte, un flot de lumière se répand sur le parvis, jusqu’à ses pieds, avec une tiède odeur d’encens. Il pénètre sous les voûtes jaunies par le reflet des cierges, et se dirige vers le poêle où se meurt un petit feu de houille. Il tend avidement ses mains et ses pieds vers la fonte brûlante : il passe ensuite ses mains sur ses jambes et sur ses bras pour les imprégner de la chaleur du poêle, et une douce action de grâces s’élève de son cœur pour remercier le Sauveur qui, aux approches de la grande nuit de Noël, lui donne du feu pour se réchauffer.
L’église est silencieuse : on n’entend dans les nefs muettes que le grincement des chaises sur les dalles bleues, le pas du sacristain dans le chœur, et le claquement des sabots, lorsque les vieilles femmes en manteau noir se dirigent du côté du bénitier afin d’y tremper leurs doigts avant de sortir. Et de temps à autre une d’entre elles s’arrête près du poêle et ouvre au feu ses petites mains sèches, en regardant de côté avec défiance le jeune vagabond. Il sent alors glisser dans son sang une chaude langueur ; sa tête retombe sur sa poitrine ; il s’affaisse dans son vieux manteau troué dont il s’est fait un oreiller. Une voix irritée éclate tout à coup à son oreille. C’est le sacristain qui lui fait signe de partir. Il se lève, regarde fièrement cet homme qui le chasse, ramasse son violon et s’en va, lentement, en boitant, car ses pieds ont gonflé dans les vieilles bandelettes de cuir qui retiennent ses souliers à ses jambes. Il ouvre la porte, et la bise glacée le frappe de nouveau au visage.
Alors le jeune garçon se parle ainsi à lui-même :
– Francesco, mon pauvre Francesco, pourquoi as-tu quitté la montagne ? Tu avais une mère à la montagne et tu l’as quittée. Où sont les autres, ceux qui m’ont précédé dans mon tour du monde ? Paolo est mort dans la campagne, pendant qu’il faisait chaud encore et que les arbres étaient verts. Il a bien du bonheur, Paolo ! Un jour, quand il gèle et qu’on n’a plus la force de marcher, on regarde derrière soi et l’on cherche de quel côté du ciel est la montagne. C’est alors, mon Francesco, que le chemin paraît long et l’on se dit qu’on n’arrivera jamais. J’ai perdu en chemin Paolo, et Pietro aussi, mon cher Pietro, plus jeune que moi de deux ans, et les autres m’ont quitté en me disant : Bon voyage. Buppo était le plus grand, mais il toussait. Que sera-t-il arrivé de lui et des autres ? Bonjour, Buppo, Paolo, Pietro et les autres. Ce sera tantôt la nuit de Noël ; il y a fête dans le ciel et ceux de la montagne sont descendus vers Naples. Tous les ans, à la Noël, nous allions à Naples, avec les cornemuses et les violons, et les gens nous donnaient de la galette, du fromage, des fruits ou de petites pièces de monnaie, tout le long du chemin. Naples ! Naples ! Et tout le long du chemin, il y avait des crèches avec l’âne, les mages et notre Sauveur, devant lesquelles ronflaient les cornemuses et chantaient les hommes de la plaine. Chez les hommes d’ici il n’y a point de crèches et les mains ne jettent que du cuivre rouge. Ma mère me disait : « Francesco, tu es le dernier de mes entrailles et je te vois partir avec douleur. Mais on est riche où tu vas : voilà pourquoi je ne veux pas te retenir. Dieu soit avec toi ! Quand tu reviendras, je pourrai mourir. Va donc, mon cher enfant. » Puis elle m’a donné ce violon et elle est venue avec les autres mères jusqu’aux montagnes qui paraissent bleues quand on les voit de loin. Ensuite elles sont restées les bras tendus, et quand le soir est venu, nous avons joué de la cornemuse et du violon, afin qu’elles pussent encore nous entendre. Et maintenant, je reviens, mais plus pauvre que lorsque je suis parti, car je n’ai plus d’espérance.
En ce moment il entendit à quelques pas de lui trois petits garçons qui chantaient à la porte d’une maison, et l’un d’eux tenait au bout d’un bâton une lanterne où brûlait une chandelle. C’étaient des enfants de la campagne, en sabots, avec des écharpes sur la tête, et ils chantaient des complaintes de Noël pour gagner quelques sous. Le plus grand se haussait sur la pointe des pieds et chantait à travers le trou de la serrure, afin qu’on l’entendît mieux de l’intérieur ; le second chantait en tournant sur lui-même, les mains dans les poches, et l’on voyait sa bouche large ouverte, car il criait de toutes ses forces ; le troisième criait aussi, mais il s’interrompait à tout moment pour renifler car son nez coulait, et il se remettait à crier avec une telle force que sa voix semblait devoir se briser. Et tantôt l’un, tantôt l’autre disait : « Plus fort », pendant que celui qui avait le nez à la serrure tapait de petits coups du bout de son sabot contre la porte : alors ils se mettaient à crier tous les trois comme des diables. Et leur chanson était à l’unisson ; mais l’un avait déjà fini quand l’autre commençait, et le dernier courait toujours après le premier, sans pouvoir l’atteindre. La petite chandelle tremblante éclairait leurs nez rouges et faisait danser leur ombre derrière eux jusqu’au bout de la rue : et eux-mêmes dansaient à la dernière note de la chanson, en sautant et en retombant sur le plat de leurs sabots, sans rire. Et voici ce que disait leur chanson :
– Noël ! Ils sont venus, les petits – Les petits et les plus petits encore – Dire bonjour à l’âne du Seigneur – De Notre Seigneur Jésus-Christ. – Il y a du foin et des navets cuits – Des carottes et du pain bénit. – Mangez, les gens, les bêtes aussi, – Koekebakken et pain cuit. – Noël ! Noël ! Amen !
– Noël ! baas ! dirent les rois. – Du foin pour nos trois chevaux, – Mais pour nous des koekebakken – Lesquels nos dents couperont. – S’il en reste un tout petit morceau, – Mettez de côté pour les cochons. – Mangez, les gens, les bêtes aussi, – Koekebakken et pain cuit. – Noël ! Noël ! Amen !
– Pour chandelle une petite étoile – Montre là où dort Notre Seigneur – Dans son maillot cousu de fil blanc. – Sur la paille qui est dans la crèche, – Il dort, le joli petit mouton. – Blokke kloppen (Les sabots cognent). S’il s’éveille, c’est pour mourir. – Mangez, les gens, les bêtes aussi, – Koekebakken et pain cuit. – Noël ! Noël ! Amen !
– Car il mourra pour nous sauver de l’enfer, – Jésus-Christ, le fils de notre chère Dame. – Les petits et les plus petits encore – Auront le cramique et du beurre en paradis – Avec de la bonne musique de violon. – Mangez, les gens, les bêtes aussi, – Koekebakken et pain cuit. – Noël ! Noël ! Amen !
– Oh ! baas, Si vous êtes contents des petits enfants, – Donnez-leur, par amour de Christus, – De l’argent pour acheter des couques – Des couques avec des prientjes (Petites figures de plâtre que les boulangers flamands mettent sur leurs pâtisseries de Noël). dessus. – Blokke kloppen. Nous ôterons nos sabots pour y faire coucher le chat. – Mangez, les gens, les bêtes aussi, – Koekebakken et pain cuit. – Noël ! Noël ! Amen !
Les trois petits garçons allaient recommencer pour la troisième fois leur complainte quand ils entendirent tout à coup jouer du violon à côté d’eux : c’était Francesco qui, humble et souriant, les accompagnait, et du pied il battait la mesure pour tâcher d’être d’accord avec eux. Ils cessèrent alors de chanter, et le plus grand mit son poing sous le nez de Francesco en lui disant : – Nous ne voulons partager notre argent avec personne.
Ainsi chassé, il s’en va, de rue en rue, jouant à la porte des maisons et devant les boutiques, mais l’archet glisse à peine sur les cordes, car les crins en sont gelés.
Où passera-t-il la nuit ? Au fond d’une cour sombre, sous un hangar, une charrette de paille est remisée. Il pénètre doucement dans le hangar et soulève la paille pour se glisser dessous. Un chien sort en ce moment de sa niche et fait entendre des aboiements furieux. Il revient sur ses pas et se dirige vers cette maison où la charité, la grâce et la douceur lui sont apparues sous les traits de Leentje ! Voici, en effet, la belle maison blanche avec sa grande porte peinte en chêne sur laquelle les poignées de bronze imitent des têtes de lions, et un peu au-dessus, dans le panneau de gauche, une superbe plaque de cuivre reluisante étale le nom de Capelle et Cie, gravée en grosses lettres. Il regarde les fenêtres partout closes, et il y en a trois au premier étage qui sont éclairées.
Qui donc est encore éveillé dans la maison ? Les sons d’un piano, comme une musique de paradis, s’échappent par les fentes des volets, et bientôt une petite voix d’or s’élève dans le silence de la nuit. Cette voix lui rappelle le murmure avec lequel sa mère le berçait, les chants des petits enfants de la montagne, le vent dans les arbres, mille choses tendres et lointaines. Puis la voix cesse, mais il l’entend longtemps encore, comme un chant de Noël, au fond de son cœur.
Des portes s’ouvrent dans la rue et il en sort des ombres qui marchent rapidement ; quelques-unes balancent à la main de petites lanternes qui rougissent la neige, car les réverbères de la ville sont éteints. Toutes ces petites lanternes se dirigent du même côté, là où la cloche sonne pour la messe de minuit. La porte de la maison Cappelle et Cie s’ouvre aussi et une joyeuse lumière se répand au-dehors : des hommes et des femmes, chaudement vêtus, serrent la main au maître de la maison, et une petite voix, celle qui a chanté, leur jette le bonsoir ; puis la compagnie se sépare en riant, la porte se referme et les fenêtres où brillait l’éclat des lampes, une à une s’obscurcissent. Ah ! M. Cappelle a voulu fêter le réveillon et il a bien fait les choses : on a bu du thé, du vin chaud et du punch ; la table est encore remplie de beaux pâtés et de belles tartes dans lesquels le couteau a taillé de grandes brèches. Mina déshabille Leentje et la couche dans des draps chauds, après l’avoir embrassée ; et au moment de s’endormir, Leentje tourne la tête du côté de son arbre de Noël, qu’elle a fait monter dans la chambre, avec la poupée, les étuis, les boîtes à ouvrages et les cornets de dragées. Alors la lumière qui danse au haut de la maison sur le rideau de Leentje, comme une étoile dans le brouillard, s’éteint à son tour, et l’obscurité enveloppe le doux sommeil de la fille de M. Cappelle.
IV
Ah ! qu’ils sont gais, les petits flocons de neige, lorsque, pareils à des papillons d’hiver bondissant sur le tremplin de la bise, ils montent, descendent, montent encore et qu’un enfant passe, à travers la fenêtre entr’ouverte, sa main dodue pour les saisir ! Qu’ils sont gais pour tout autre que le pauvre Francesco, dans cette nuit glacée de Noël ! De grosses larmes roulent au bord de ses yeux, tandis qu’il souffle son haleine sur le bout de ses doigts. Le monde est bien dur ! Que va-t-il faire maintenant ? Il voit dans l’ombre une porte profonde dont la neige n’a pas recouvert le seuil ; il y va. Tenez, le voilà qui s’assied, après avoir eu soin de tirer son manteau sous lui ; et son menton sur ses genoux, il s’endort.
Tout à coup il lui semble que la terre s’est dérobée sous ses pieds. Est-ce lui qui monte ? Est-ce la terre qui descend ? Qu’importe ! Ce qui se découvre à ses yeux est bien plus beau que la terre. Et tout de suite il sent une odeur délicieuse, comme celle qui sortait de la cave du pâtissier. L’air est embaumé de vanille, de safran, de cannelle, de citron, et un petit vent chaud répand ces bonnes odeurs au loin. Dieu ! Qu’elles sont enivrantes ! Il les sent couler dans ses veines comme le jus des fruits mûrs.
De magnifiques campagnes s’étendent à présent devant lui, avec des tons de pourpre, d’émeraude et de turquoise, jusqu’aux horizons de montagnes qui dentellent l’azur du ciel. Et un abricot, étincelant comme un soleil, répand sa lumière sur les gelées, les sirops et les crèmes du paysage. Jamais le vrai soleil ne lui a paru à la fois si brillant et si humide !
« Seigneur ! Seigneur ! Que tout cela est bon et qu’il fait doux de vivre ! » Ainsi se parle Francesco, car il vient de prendre un bain dans la crème et il a mangé trois îles coup sur coup.
Puis une montagne en caramel se dresse devant lui, surmontée de la même tour qu’il a vue chez le pâtissier. Qui donc habite la tour ? Ce ne peut être qu’une fée, et la fée sans doute est la reine du pays qu’il vient de parcourir.
Mais comment pénétrer dans la muette et splendide tour ? Il cherche en vain la sonnette. Toc, toc ! fait-il enfin. Et une voix, douce comme de la confiture, lui répond du fond de la tour : Entrez.
Il entre.
De grands escaliers en sucre montent d’une galerie de pouding vers une galerie de nougat. Toc, toc ! fait-il encore. Et la même voix répond : Plus haut.
Toujours frappant, il arrive à la dernière galerie, qui est en biscuit aux amandes, après avoir passé par toute sorte de merveilles ; et tout à coup il se trouve en présence de la petite danseuse du pâtissier. Elle lui sourit très gentiment et lui dit :
– Je t’attendais, mon petit Francesco.
À vrai dire, elle n’était plus posée sur la pointe de son orteil, la jambe droite levée, comme il l’avait aperçue la première fois, au haut de la tour, chez le pâtissier. Non, elle était debout sur ses deux pieds et lui tendait la main, à présent.
Jamais Francesco n’avait vu une si jolie personne, ni plus mignonne, ni plus potelée, ni mieux faite, et elle était tout en sucre, avec des couleurs éclatantes qui la rendaient encore plus à son goût. Oh ! C’était de bon sucre, allez ! et si appétissant que Francesco, qui ne savait que répondre à la jolie personne, se mit à lui lécher le cou, sous ses cheveux blond-cendré.
D’où vient qu’il pensa tout à coup que cette jolie créature était la même que celle qui lui avait fait la charité, tandis qu’il se trouvait encore sur la terre ? Et comme si la petite danseuse eût compris ce qui se passait en lui, elle lui dit :
– Oui, c’est bien moi. Voici ma main : épousons-nous. Mon royaume sera aussi le tien.
Alors, Francesco mit sa main dans la sienne et ils furent mariés.
Le bel abricot couleur de soleil s’obscurcit en ce moment : aussitôt une teinte crépusculaire revêtit la crête des monts, et la plaine entière se couvrit d’une couche glacée de confitures aux lueurs sombres.
– Voici la nuit, Francesco, lui dit la petite fille en sucre, nous allons nous séparer.
Et Francesco la vit fondre lentement, comme une étoile dans les clartés croissantes du matin, et la tour se fondit, et les montagnes se fondirent et les paysages se mirent à fondre aussi pendant que lui-même se sentait fondre, fondre toujours un peu plus.
Jusqu’à ce que...
Le matin la servante de la maison, en ouvrant la porte pour aller chez le boulanger, trouva sur le seuil un petit cadavre glacé.
– Chut ! ne le réveillons pas. Il est parti, le pauvre Francesco, sur l’aile du rêve à travers la nuit de Noël.
Camille Lemonnier
Guy de Maupassant, 25 décembre 1882
Le docteur Bonenfant cherchait dans sa mémoire, répétant à mi-voix :
« Un souvenir de Noël ?... Un souvenir de Noël ?... »
Et tout à coup, il s'écria :
- Mais si, j'en ai un, et un bien étrange encore ; c'est une histoire fantastique. J'ai vu un miracle ! Oui, mesdames, un miracle, la nuit de Noël. Cela vous étonne de m'entendre parler ainsi, moi qui ne crois guère à rien. Et pourtant j'ai vu un miracle ! Je l'ai vu, fis-je, vu, de mes propres yeux vu, ce qui s'appelle vu. En ai-je été fort surpris ? non pas ; car si je ne crois point à vos croyances, je crois à la foi, et je sais qu'elle transporte les montagnes. Je pourrais citer bien des exemples ; mais je vous indignerais et je m'exposerais aussi à amoindrir l'effet de mon histoire. Je vous avouerai d'abord que si je n'ai pas été fort convaincu et converti par ce que j'ai vu, j'ai été du moins fort ému, et je vais t'cher de vous dire la chose naïvement, comme si j'avais une crédulité d'Auvergnat.
J'étais alors médecin de campagne, habitant le bourg de Rolleville, en pleine Normandie.
L'hiver, cette année-là, fut terrible. Dès la fin de novembre, les neiges arrivèrent après une semaine de gelées. On voyait de loin les gros nuages venir du nord ; et la blanche descente des flocons commença.
En une nuit, toute la plaine fut ensevelie
Les fermes, isolées dans leurs cours carrées, derrière leurs rideaux de grands arbres poudrés de frimas, semblaient s'endormir sous l'accumulation de cette mousse épaisse et légère.
Aucun bruit ne traversait plus la campagne immobile. Seuls les corbeaux, par bandes, décrivaient de longs festons dans le ciel, cherchant leur vie inutilement, s'abattant tous ensemble sur les champs livides et piquant la neige de leurs grands becs.
On n'entendait rien que le glissement vague et continu de cette poussière tombant toujours.
Cela dura huit jours pleins, puis l'avalanche s'arrêta. La terre avait sur le dos un manteau épais de cinq pieds.
Et, pendant trois semaines ensuite, un ciel clair, comme un cristal bleu le jour, et, la nuit, tout semé d'étoiles qu'on aurait crues de givre, tant le vaste espace était rigoureux, s'étendit sur la nappe unie, dure et luisante des neiges.
La plaine, les haies, les ormes des clôtures, tout semblait mort, tué par le froid. Ni hommes ni bêtes ne sortaient plus : seules les cheminées des chaumières en chemise blanche révélaient la vie cachée, par les minces filets de fumée qui montaient droit dans l'air glacial. De temps en temps on entendait craquer les arbres, comme si leurs membres de bois se fussent brisés sous l'écorce ; et, parfois, une grosse branche se détachait et tombait, l'invincible gelée pétrifiant la sève et cassant les fibres.
Les habitations semées çà et là par les champs semblaient éloignées de cent lieues les unes des autres. On vivait comme on pouvait. Seul, j'essayais d'aller voir mes clients les plus proches, m'exposant sans cesse à rester enseveli dans quelque creux.
Je m'aperçus bientôt qu'une terreur mystérieuse planait sur le pays. Un tel fléau, pensait-on, n'était point naturel. On prétendit qu'on entendait des voix la nuit, des sifflements aigus, des cris qui passaient. Ces cris et ces sifflements venaient sans aucun doute des oiseaux émigrants qui voyagent au crépuscule, et qui fuyaient en masse vers le sud. Mais allez donc faire entendre raison à des gens affolés. Une épouvante envahissait les esprits et on s'attendait à un événement extraordinaire.
La forge du père Vatinel était située au bout du hameau d'Épivent, sur la grande route, maintenant invisible et déserte. Or, comme les gens manquaient de pain, le forgeron résolut d'aller jusqu'au village. Il resta quelques heures à causer dans les six maisons qui forment le centre du pays, prit son pain et des nouvelles, et un peu de cette peur épandue sur la campagne.
Et il se mit en route avant la nuit.
Tout à coup, en longeant une haie, il crut voir un œuf dans la neige ; oui, un œuf déposé là, tout blanc comme le reste du monde. Il se pencha, c'était un œuf en effet. D'où venait-il ? Quelle poule avait pu sortir du poulailler et venir pondre en cet endroit ? Le forgeron s'étonna, ne comprit pas ; mais il ramassa l'œuf et le porta à sa femme.
« Tiens, la maîtresse, v'là un œuf que j'ai trouvé sur la route ! »
La femme hocha la tête :
« Un œuf sur la route ? Par ce temps-ci, t'es soûl, bien sûr ?
- Mais non, la maîtresse, même qu'il était au pied d'une haie, et encore chaud, pas gelé. Le v'là, j'me l'ai mis sur l'estomac pour qui n'refroidisse pas. Tu le mangeras pour ton dîner. »
L'œuf fut glissé dans la marmite où mijotait la soupe, et le forgeron se mit à raconter ce qu'on disait par la contrée.
La femme écoutait toute p'le. « Pour sûr que j'ai entendu des sifflets l'autre nuit, même qu'ils semblaient v'nir de la cheminée. »
On se mit à table, on mangea la soupe d'abord, puis, pendant que le mari étendait du beurre sur son pain, la femme prit l'œuf et l'examina d'un œil méfiant.
« Si y avait quelque chose dans c't'œuf ?
Qué que tu veux qu'y ait ?
- J'sais ti, mé ?
- Allons, mange-le, et fais pas la bête. »
Elle ouvrit l'œuf. Il était comme tous les œufs, et bien frais.
Elle se mit à le manger en hésitant, le goûtant, le laissant, le reprenant. Le mari disait : « Eh bien ! qué goût qu'il a, c't'œuf ? » Elle ne répondit pas et elle acheva de l'avaler ; puis, soudain, elle planta sur son homme des yeux fixes, hagards, affolés, leva les bras, les tordit et, convulsée de la tête aux pieds, roula par terre, en poussant des cris horribles. Toute la nuit elle se débattit en des spasmes épouvantables, secouée de tremblements effrayants, déformée par de hideuses convulsions. Le forgeron, impuissant à la tenir, fut obligé de la lier. Et elle hurlait sans repos, d'une voix infatigable :
« J'l'ai dans l'corps ! J'l'ai dans l'corps ! »
Je fus appelé le lendemain. J'ordonnai tous les calmants connus sans obtenir le moindre résultat. Elle était folle.
Alors, avec une incroyable rapidité, malgré l'obstacle des hautes neiges, la nouvelle, une nouvelle étrange, courut de ferme en ferme : « La femme du forgeron qu'est possédée ! » Et on venait de partout, sans oser pénétrer dans la maison ; on écoutait de loin ses cris affreux poussés d'une voix si forte qu'on ne les aurait pas crus d'une créature humaine.
Le curé du village fut prévenu. C'était un vieux prêtre naïf. Il accourut en surplis comme pour administrer un mourant et il prononça, en étendant les mains, les formules d'exorcisme, pendant que quatre hommes maintenaient sur un lit la femme écumante et tordue.
Mais l'esprit ne fut point chassé.
Et la Noël arriva sans que le temps eût changé.
La veille au matin, le prêtre vint me trouver :
« J'ai envie, dit-il, de faire assister à l'office de cette nuit cette malheureuse. Peut-être Dieu fera-t-il un miracle en sa faveur, à l'heure même où il naquit d'une femme. »
Je répondis au curé :
« Je vous approuve absolument, monsieur l'abbé. Si elle a l'esprit frappé par la cérémonie (et rien n'est plus propice à l'émouvoir), elle peut être sauvée sans autre remède. »
Le vieux prêtre murmura :
« Vous n'êtes pas croyant, docteur, mais aidez-moi, n'est-ce pas ? Vous vous chargez de l'amener ? »
Et je lui promis mon aide.
Le soir vint, puis la nuit; et la cloche de l'église se mit à sonner, jetant sa voix plaintive à travers l'espace morne, sur l'étendue blanche et glacée des neiges.
Des êtres noirs s'en venaient lentement, par groupes, dociles au cri d'airain du clocher. La pleine lune éclairait d'une lueur vive et blafarde tout l'horizon, rendait plus visible la p'le désolation des champs.
J'avais pris quatre hommes robustes et je me rendis à la forge.
La possédée hurlait toujours, attachée à sa couche. On la vêtit proprement malgré sa résistance éperdue, et on l'emporta.
L’église était maintenant pleine de monde, illuminée et froide ; les chantres poussaient leurs notes monotones ; le serpent ronflait ; la petite sonnette de l'enfant de chœur tintait, réglant les mouvements des fidèles. J'enfermai la femme et ses gardiens dans la cuisine du presbytère, et j'attendis le moment que je croyais favorable.
Je choisis l'instant qui suit la communion. Tous les paysans, hommes et femmes, avaient reçu leur Dieu pour fléchir sa rigueur. Un grand silence planait pendant que le prêtre achevait le mystère divin. Sur mon ordre, la porte fut ouverte et les quatre aides apportèrent la folle.
Dès qu'elle aperçut les lumières, la foule à genoux, le chœur en feu et le tabernacle doré, elle se débattit d'une telle vigueur, qu'elle faillit nous échapper, et elle poussa des clameurs si aiguës qu'un frisson d'épouvante passa dans l'église ; toutes les têtes se relevèrent ; des gens s'enfuirent. Elle n'avait plus la forme d'une femme, crispée et tordue en nos mains, le visage contourné, les yeux fous.
On la traîna jusqu'aux marches du chœur et puis on la tint fortement accroupie à terre.
Le prêtre s'était levé ; il attendait. Dès qu'il la vit arrêtée, il prit en ses mains l'ostensoir ceint de rayons d'or, avec l'hostie blanche au milieu, et, s'avançant de quelques pas, il l'éleva de ses deux bras tendus au-dessus de sa tête, le présentant aux regards effarés de la démoniaque. . Elle hurlait toujours, l'œil fixé, tendu sur cet objet rayonnant.
Et le prêtre demeurait tellement immobile qu'on l'aurait pris pour une statue.
Et cela dura longtemps, longtemps.
La femme semblait saisie de peur, fascinée ; elle contemplait fixement l'ostensoir, secouée encore de tremblements terribles, mais passagers, et criant toujours, mais d'une voix moins déchirante. Et cela dura encore longtemps.
On eût dit qu'elle ne pouvait plus baisser les yeux, qu'ils étaient rivés sur l'hostie ; elle ne faisait plus que gémir ; et son corps raidi s'amollissait, s'affaissait.
Toute la foule était prosternée, le front par terre.
La possédée maintenant baissait rapidement les paupières, puis les relevait aussitôt, comme impuissante à supporter la vue de son Dieu. Elle s'était tue. Et puis soudain, je m'aperçus que ses yeux demeuraient clos. Elle dormait du sommeil des somnambules, hypnotisée, pardon ! Vaincue par la contemplation persistante de l'ostensoir aux rayons d'or, terrassée par le Christ victorieux.
On l'emporta, inerte, pendant que le prêtre remontait vers l'autel.
L'assistance, bouleversée, entonna le Te Deum d'action de grâces.
Et la femme du forgeron dormit quarante heures de suite, puis se réveilla sans aucun souvenir de la possession ni de la délivrance.
Voilà, mesdames, le miracle que j'ai vu.
Le docteur Bonenfant se tut, puis ajouta d'une voix contrariée : « Je n'ai pu refuser de l'attester par écrit. ».
Les trois messes basses
Conte de Noël
- Deux dindes truffées, Garrigou ?...
- Oui, mon révérend, deux dindes magnifiques bourrées de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était tendue...
- Jésus maria ! moi qui aime tant les truffes !... Donne-moi vite mon surplis, Garrigou... Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine ?...
- Oh ! toutes sortes de bonnes choses... depuis midi nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des gelinottes, des coqs de bruyère. La plume en volait partout... Puis de l'étang on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des...
- Grosses comment, les truites, Garrigou ?
- Grosses comme ça, mon révérend... Énormes !...
- Oh ! Dieu ! Il me semble que je les vois... As-tu mis le vin dans les burettes ?
- Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes...
Mais dame ! Il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyiez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent pleines de vins de toutes les couleurs... Et la vaisselle d'argent, les surtouts ciselés, les fleurs, les candélabres !... Jamais il ne se sera vu un réveillon pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage.
Vous serez au moins quarante à table, sans compter le bailli ni le tabellion... Ah ! vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend !... Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit partout... Meuh !...
- Allons, allons, mon enfant. Gardons-nous du péché de gourmandise, surtout la nuit de la Nativité... Va bien vite allumer les cierges et sonner Le premier coup de la messe ; car voilà que minuit est proche, et il ne faut pas nous mettre en retard...
Cette conversation se tenait une nuit de Noël de l'an de grâce mil six cent et tant, entre le révérend dom Balaguère, ancien prieur des Barnabites, présentement chapelain gagé des sires de Trinquelage, et son petit clerc Garrigou, ou du moins ce qu'il croyait être le petit clerc Garrigou, car vous saurez que le diable, ce soir-là, avait pris la face ronde et les traits indécis du jeune sacristain pour mieux induire le révérend père en tentation et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise.
Donc, pendant que le soi-disant Garrigou (hum ! hum !) faisait à tour de bras carillonner les cloches de la chapelle seigneuriale, le révérend achevait de revêtir sa chasuble dans la petite sacristie du château ; et, l'esprit déjà troublé par toutes ces descriptions gastronomiques, il se répétait à lui-même en s'habillant :
- Des dindes rôties... des carpes dorées... des truites grosses comme ça!...
Dehors, le vent de la nuit soufflait en éparpillant la musique des cloches, et, à mesure, des lumières apparaissaient dans l'ombre aux flancs du mont Ventoux, en haut duquel s'élevaient les vieilles tours de Trinquelage. C'étaient des familles de métayers qui venaient entendre la messe de minuit au château. Ils grimpaient la côte en chantant par groupes de cinq ou six, le père en avant, la lanterne en main, les femmes enveloppées dans leurs grandes mantes brunes où les enfants se serraient et s'abritaient. Malgré l'heure et le froid, tout ce brave peuple marchait allégrement, soutenu par l'idée qu'au sortir de la messe, il y aurait, comme tous les ans, table mise pour eux en bas dans les cuisines. De temps en temps, sur la rude montée, le carrosse d'un seigneur précédé de porteurs de torches, faisait miroiter ses glaces au clair de lune, ou bien une mule trottait en agitant ses sonnailles, et à la lueur des falots enveloppés de brume, les métayers reconnaissaient leur bailli et le saluaient au passage :
- Bonsoir bonsoir maître Arnoton !
- Bonsoir, bonsoir, mes enfants !
La nuit était claire, les étoiles avivées de froid ; la bise piquait, et un fin grésil, glissant sur les vêtements sans les mouiller, gardait fidèlement la tradition des Noëls blancs de neige. Tout en haut de la côte, le château apparaissait comme le but, avec sa masse énorme de tours, de pignons, le clocher de sa chapelle montant dans le ciel bleu noir, et une foule de petites lumières qui clignotaient, allaient, venaient, s'agitaient à toutes les fenêtres, et ressemblaient, sur le fond sombre du bâtiment, aux étincelles courant dans des cendres de papier brûlé... Passé le pont-levis et la poterne, il fallait, pour se rendre à la chapelle, traverser la première cour, pleine de carrosses, de valets, de chaises à porteurs, toute claire du feu des torches et de la flambée des cuisines. On entendait le tintement des tournebroches, le fracas des casseroles, le choc des cristaux et de l'argenterie remués dans les apprêts d'un repas ; par là-dessus, une vapeur tiède, qui sentait bon les chairs rôties et les herbes fortes des sauces compliquées, faisait dire aux métayers, comme au chapelain, comme au bailli, comme à tout le monde :
- Quel bon réveillon nous allons faire après la messe !
Drelindin din !... Drelindin din !...
C'est la messe de minuit qui commence. Dans la chapelle du château, une cathédrale en miniature, aux arceaux entrecroisés, aux boiseries de chêne, montant jusqu'à hauteur des murs, les tapisseries ont été tendues, tous les cierges allumés. Et que de monde ! Et que de toilettes! Voici d'abord, assis dans les stalles sculptées qui entourent le chœur le sire de Trinquelage, en habit de taffetas saumon, et près de lui tous les nobles seigneurs invités. En face, sur des prie-Dieu garnis de velours, ont pris place la vieille marquise douairière dans sa robe de brocart couleur de feu et la jeune dame de Trinquelage, coiffée d'une haute tour de dentelle gaufrée à la dernière mode de la cour de France. Plus bas on voit, vêtus de noir avec de vastes perruques en pointe et des visages rasés, le bailli Thomas Arnoton et le tabellion maître Ambroy, deux notes graves parmi les soies voyantes et les damas brochés. Puis viennent les gras majordomes, les pages, les piqueurs, les intendants, dame Barbe, toutes ses clefs pendues sur le côté à un clavier d'argent fin. Au fond, sur les bancs, c'est le bas office, les servantes, les métayers avec leurs familles ; et enfin, là-bas, tout contre la porte qu'ils entrouvrent et referment discrètement, messieurs les marmitons qui viennent entre deux sauces prendre un petit air de messe et apporter une odeur de réveillon dans l'église toute en fête et tiède de tant de cierges allumés.
Est-ce la vue de ces petites barrettes blanches qui donne des distractions à l'officiant ? Ne serait-ce pas plutôt la sonnette de Garrigou, cette enragée petite sonnette qui s'agite au fond de l'autel avec une précipitation infernale et semble dire tout le temps:
- Dépêchons-nous, dépêchons-nous... Plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons à table.
Le fait est que chaque fois qu'elle tinte, cette sonnette du diable, le chapelain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon. Il se figure les cuisiniers en rumeur, les fourneaux où brûle un feu de forge, la buée qui monte des couvercles entrouverts, et dans cette buée deux dindes magnifiques bourrées, tendues, marbrées de truffes...
Ou bien encore il voit passer des files de pages portant des plats enveloppés de vapeurs tentantes, et avec eux il entre dans la grande salle déjà prête pour le festin.
Ô délices ! voilà l'immense table toute chargée et flamboyante, les paons habillés de leurs plumes, les faisans écartant leurs ailes mordorées, les flacons couleur de rubis, les pyramides de fruits éclatants parmi les branches vertes, et ces merveilleux poissons dont parlait Garrigou (ah ! bien oui, Garrigou!) étalés sur un lit de fenouil, l'écaille nacrée comme s'ils sortaient de l'eau, avec un bouquet d'herbes odorantes dans leurs narines de monstres. Si vive est la vision de ces merveilles, qu'il semble à dom Balaguère que tous ces plats mirifiques sont servis devant lui sur es broderies de la nappe d'autel, et deux ou trois fois, au lieu de Dominus vobiscum ! Il se surprend à dire le Bénédicité. À part ces légères méprises, le digne homme débite son office très consciencieusement, sans passer une ligne, sans omettre une génuflexion ; et tout marche assez bien jusqu'à la fin de la première messe ; car vous savez que le jour de Noël le même officiant doit célébrer trois messes consécutives.
- Et d'une ! se dit le chapelain avec un soupir de soulagement; puis, sans perdre une minute, il fait signe à son clerc ou celui qu'il croit être son clerc, et...
Drelindin din !... Drelindin din !... C'est la seconde messe qui commence, et avec elle commence aussi le péché de dom Balaguère.
-Vite, vite, dépêchons-nous, lui crie de sa petite voix aigrelette la sonnette de Garrigou, et cette fois le malheureux officiant, tout abandonné au démon de gourmandise, se rue sur le missel et dévore les pages avec l'avidité de son appétit en surexcitation. Frénétiquement il se baisse, se relève, esquisse les signes de croix, les génuflexions, raccourcit tous ses gestes pour avoir plus tôt fini. À peine s'il étend ses bras à l'Évangile, s'il frappe sa poitrine au Confiteor. Entre le clerc et lui c'est à qui bredouillera le plus vite.
Versets et répons se précipitent, se bousculent. Les mots à moitié prononcés, sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait trop de temps, s'achèvent en murmures incompréhensibles.
Oremus ps... p,ç... p,i...
Mea culpa... pa... pa...
Pareils à des vendangeurs pressés foulant le raisin de la cuve, tous deux barbotent dans le latin de la messe, en envoyant des éclaboussures de tous les côtés.
Dom... scum !... dit Balaguère.
...Stutuo !... répond Garrigou ; et tout le temps la damnée petite sonnette est là qui tinte à leurs oreilles, comme ces grelots qu'on met aux chevaux de poste pour les faire galoper à la grande vitesse. Pensez que de ce train-là une messe basse est vite expédiée.
- Et de deux ! dit le chapelain tout essoufflé ; puis, sans prendre le temps de respirer, rouge, suant, il dégringole les marches de l'autel et...
Drelindin din !... Drelindin din !...
C'est la troisième messe qui commence. Il n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver à la salle à manger ; mais, hélas! à mesure que le réveillon approche, l'infortuné Balaguère se sent pris d'une folie d'impatience et de gourmandise. Sa vision s'accentue, les carpes dorées, les dindes rôties sont là, là... Il les touche... il les... Oh ! Dieu !... Les plats fument, les vins embaument : et, secouant son grelot enragé, la petite sonnette lui crie :
- Vite, vite, encore plus vite !...
Mais comment pourrait-il aller plus vite ? Ses lèvres remuent à peine. Il ne prononce plus les mots... À moins de tricher tout à fait avec le bon Dieu et de lui escamoter sa messe... Et c'est ce qu'il fait, le malheureux !... De tentation en tentation, il commence par sauter un verset, puis deux. Puis l'épître est trop longue, il ne la finit pas, effleure l'Évangile, passe devant le Credo sans entrer, saute le Pater, salue de loin la préface, et par bonds et par élans se précipite ainsi dans la damnation éternelle, toujours suivi de l'infâme Garrigou (vade retro, Satanas.), qui le seconde avec une merveilleuse entente, lui relève sa chasuble, tourne les feuillets deux par deux, bouscule les pupitres, renverse les burettes, et sans cesse secoue la petite sonnette de plus en plus fort, de plus en plus vite.
Il faut voir la figure effarée que font tous les assistants !
Obligés de suivre à la mimique du prêtre cette messe dont ils n'entendent pas un mot, les uns se lèvent quand les autres s'agenouillent, s'asseyent quand les autres sont debout ; et toutes les phases de ce singulier office se confondent sur les bancs dans une foule d'attitudes diverses. L'étoile de Noël en route dans les chemins du ciel, là-bas, vers la petite étable, pâlit d'épouvante en voyant cette confusion...
- l'abbé va trop vite... On ne peut pas suivre, murmure la vieille douairière en agitant sa coiffe avec égarement.
Maître Arnoton, ses grandes lunettes d'acier sur le nez, cherche dans son paroissien où diantre on peut bien en être. Mais au fond, tous ces braves gens, qui eux aussi pensent à réveillonner ne sont pas fâchés que la messe aille ce train de poste ; et quand dom Balaguère, la figure rayonnante, se tourne vers l'assistance en criant de toutes ses forces : Ite, missa est, il n'y a qu'une voix dans la chapelle pour lui répondre un Deo gratias si joyeux, si entraînant, qu'on se croirait déjà à table au premier toast du réveillon.
Cinq minutes après, la foule des seigneurs s'asseyait dans la grande salle, le chapelain au milieu d'eux. Le château, illuminé de haut en bas, retentissait de chants, de cris, de rires, de rumeurs ; et le vénérable dom Balaguère plantait sa fourchette dans une aile de gelinotte, noyant le remords de son péché sous des flots de vin du Pape et de bons jus de viandes. Tant il but et mangea, le pauvre saint homme, qu'il mourut dans la nuit d'une terrible attaque, sans avoir eu seulement le temps de se repentir ; puis, au matin, il arriva dans le ciel encore tout en rumeur des fêtes de la nuit, et je vous laisse à penser comme il y fut reçu.
- Retire-toi de mes yeux, mauvais chrétien ! lui dit le souverain Juge, notre maître à tous. Ta faute est assez grande pour effacer toute une vie de vertu... Ah ! tu m'as volé une messe de nuit... Eh bien, tu m'en payeras trois cents en place, et tu n'entreras en paradis que quand tu auras célébré dans ta propre chapelle ces trois cents messes de Noël en présence de tous ceux qui ont péché par ta faute et avec toi...
... Et voilà la vraie légende de dom Balaguère comme on la raconte au pays des olives. Aujourd'hui, le château de Trinquelage n'existe plus, mais la chapelle se tient encore droite tout en haut du mont Ventoux, dans un bouquet de chênes verts. Le vent fait battre sa porte disjointe, l'herbe encombre le seuil ; il y a des nids aux angles de l'autel et dans l'embrasure des hautes croisées dont les vitraux coloriés ont disparu depuis longtemps. Cependant il paraît que tous les ans, à Noël, une lumière surnaturelle erre parmi ces ruines, et qu'en allant aux messes et aux réveillons, les paysans aperçoivent ce spectre de chapelle, éclairé de cierges invisibles qui brûlent au grand air, même sous la neige et le vent. Vous en rirez si vous voulez, mais un vigneron de l'endroit, nommé Garrigue, sans doute un descendant de Garrigou, m'a affirmé qu'un soir de Noël, se trouvant un peu en ribote, il s'était perdu dans la montagne du côté de Trinquelage ; et voici ce qu'il avait vu...
Jusqu'à onze heures, rien. Tout était silencieux, éteint, inanimé. Soudain, vers minuit, un carillon sonna tout en haut du clocher, un vieux, vieux carillon qui avait l'air d'être à dix lieues. Bientôt, dans le chemin qui monte, Garrigue vit trembler des feux, s'agiter des ombres indécises.
Sous le porche de la chapelle, on marchait, on chuchotait :
- Bonsoir maître Arnoton !
- Bonsoir bonsoir mes enfants !...
Quand tout le monde fut entré, mon vigneron, qui était très brave, s'approcha doucement et, regardant par la porte cassée, eut un singulier spectacle. Tous ces gens qu'il avait vus passer étaient rangés autour du chœur, dans la nef en ruine, comme si les anciens bancs existaient encore.
De belles dames en brocart avec des coiffes de dentelle, des seigneurs chamarrés du haut en bas, des paysans en jaquettes fleuries ainsi qu'en avaient nos grands-pères, tous l'air vieux, fané, poussiéreux, fatigué. De temps en temps, des oiseaux de nuit, hôtes habituels de la chapelle, réveillés par toutes ces lumières, venaient rôder autour des cierges dont la flamme montait droite et vague comme si elle avait brûlé derrière une gaze ; et ce qui amusait beaucoup Garrigue, c'était un certain personnage à grandes lunettes d'acier, qui secouait à chaque instant sa haute perruque noire sur laquelle un de ces oiseaux se tenait droit tout empêtré en battant silencieusement des ailes.
Dans le fond, un petit vieillard de taille enfantine, à genoux au milieu du chœur agitait désespérément une sonnette sans grelot et sans voix, pendant qu'un prêtre, habillé de vieil or allait, venait devant l'autel, en récitant des oraisons dont on n'entendait pas un mot... Bien sûr c'était dom Balaguère, en train de dire sa troisième messe basse.
Alphonse Daudet
Les lettres de mon Moulin

Copyright © Mido. Tous droits réservés.